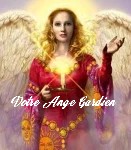Le nom du Trône KilI (EL) est constitué d’un radical composé des lettres KaPh, LaMeD et YoD à partir desquelles nous pouvons extraire le terme kelî (KaPh–LaMeD–YoD) désignant « le vêtement ». Nous pouvons également former à partir de ce radical la racine (KaPh–YoD–LaMeD) qui, prononcée kiyél, désigne « la mesure », qui, prononcée kiyél, signifie « mesurer » ou « arpenter » et qui, prononcée kayil, indique « l’arpenteur ». Quant à la particule EL, elle place ce radical dans une perspective de relation à Dieu. Pour saisir la signification profonde et l’enjeu auquel ce Trône se réfère, entreprenons donc l’analyse symbolique des mots que nous pouvons en tirer.
En ce sens, nous débuterons par l’image du vêtement. En effet, le vêtement extériorise toujours, dans une perspective traditionnelle, une fonction ou un état, la condition de l’homme et les limites dans lesquelles il peut s’exprimer et agir. Ainsi, à l’époque de l’Antiquité, on savait d’un simple coup d’œil de quel pays ou de quelle région était originaire un homme en considérant sa façon de s’habiller. Plus encore, on savait également la stratification sociale à laquelle il appartenait puisque, selon la tripartition classique, les rois et les prêtres (fonction sacerdotale), les guerriers (fonction militaire) et les travailleurs (fonction productrice) portaient des vêtements spécifiques à leurs activités.
« D’ailleurs, de façon générale, et dans toutes les sociétés, il semble bien que l’on retrouve ces distinctions puisque le chaman asiatique ou le sorcier africain portent des pièces d’habillement qui leur sont réservées, et que les guerriers ou les soldats revêtent, selon les époques et les lieux, des casaques, des tuniques, des cuirasses, des armures, des tenues, bref, d’une manière ou d’une autre, des « uniformes » qui les distinguent à coup sûr. On est même allé encore beaucoup plus loin puisque, non seulement les esclaves ont toujours dû s’habiller d’une façon qui les distinguait du reste de la société, mais la tendance a presque toujours été, à l’intérieur d’une même fonction, à différencier les rôles et les états: le grand brahmane ne s’habille pas de la même façon qu’un renonçant en Inde, un évêque qu’un simple curé en Occident, ni d’ailleurs le clergé séculier que le clergé régulier (moines) – de même qu’un officier a traditionnellement droit à des signes distinctifs par rapport à ses soldats, ou que, dans la classe productrice, et jusqu’au début de ce siècle, un bourgeois disposait de ses codes vestimentaires, différents de ceux d’un artisan ou d’un paysan. ».
- Encyclopédie des symboles, Édition française établie sous la direction de Cazenave, Michel, La Pochothèque, Le livre de Poche, Paris, 1996.
Ainsi, le vêtement exprime la place (la condition) que l’homme occupe en ce monde, tant au niveau de l’espace que du temps. En effet, si on savait autrefois reconnaître de quel pays ou de quelle région un individu était originaire en considérant sa seule façon de s’habiller, l’historien peut aussi savoir à quelle époque appartient un homme en considérant son vêtement. Le vêtement incarne donc la condition spatio-temporelle de l’homme et les limites dans le cadre desquelles s’inscrit son existence. C’est d’ailleurs pourquoi les sages de certaines castes religieuses de l’Orient vivent nus, exprimant ainsi le fait qu’ils sont en voie d’accomplissement et qu’ils se sont dégagés conséquemment des contingences de l’espace et du temps. C’est peut-être également dans la même perspective qu’il faut traduire le fait que le Christ est représenté nu sur la croix. De même, si les dieux grecs sont généralement nus ou presque, c’est pour souligner le fait qu’ils sont au-dessus de la condition humaine. Enfin, si l’Ancien de la vision de Daniel apparaissant siégeant sur un trône est vêtu de blanc, c’est aussi pour nous révéler que Dieu transcende toute limite spatio-temporelle:
« Tandis que je contemplais: Des trônes furent placés et un Ancien s’assit. Son vêtement, blanc comme la neige… ».
– Daniel VII, 9. 14
Dans le même ordre d’idée, sitôt après l’événement de la Chute au cours duquel Adam et Ève répondirent à la proposition de Satan de
« devenir comme des dieux » (c’est-à-dire de ne plus être créature, de ne plus être faible et impuissant, de ne plus assumer leur condition spatio-temporelle et les limites qu’elle fixe à leur existence), Dieu les renvoya du jardin d’Éden en les revêtant de tuniques de peau: « Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit ».
– Genèse III, 21.
Nous pourrions interpréter ce geste comme une ultime recommandation divine rappelant à l’homme qu’il est ontologiquement créature et qu’en conséquence vouloir prétendre occuper une autre place que celle qui lui revient (devenir un dieu) le conduira à sa propre perte.
Quant au fait de « mesurer » ou d’« arpenter », deux autres mots que nous avons extraits du radical, nous savons que l’arpentage est une science qui détermine un espace délimité dans lequel l’homme habite (maison) ou travaille (champs). Elle évoque donc la juste place qui lui revient dans l’univers. Les textes bibliques font d’ailleurs souvent référence à l’image d’un Dieu arpenteur donnant à chaque être et à chaque chose la juste place qui lui revient. Ainsi, Dieu s’adresse à Job en ces termes:
« Où étais-tu quand je fondai la terre ?
Parle, si ton savoir est éclairé.
Qui en fixa les mesures, le saurais-tu, ou qui tendit sur elle le cordeau ? […I
Qui enferma la mer à deux battants, quand elle sortit du sein, bondissante; quand je mis sur elle une nuée pour vêtement et fis des nuages sombres ses langes; quand je découpai pour elle sa limite et plaçai portes et verrou ?
« Tu n’iras pas plus loin, lui dis-je, ici se brisera l’orgueil de tes flots ! » » .
– Job XXXVIII, 4-11.
Le psalmiste reprendra ces propos:
« À ta menace, les eaux prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s’échappent; elles sautent les montagnes, elles descendent les vallées vers le lieu que tu leur as assigné; tu mets une limite à ne pas franchir, qu’elles ne reviennent couvrir la terre. »,
Psaume 104 (103), 7-9.
Nous pouvons donc en déduire que le Trône KilI (EL) nous invite à accepter pleinement notre condition en occupant notre juste place au sein de l’univers (la place qui est à notre juste mesure). De manière plus tangible encore, il nous apprendra également à percevoir la place qui nous revient au sein de la communauté et de l’époque à laquelle nous appartenons. Il nous enseignera ainsi à ne plus chercher à occuper la place d’autrui (qui peut apparaître, à travers nos illusions égoïques, plus valorisante), refusant d’assumer la nôtre (nous rebellant trop souvent contre ceux qui nous ont mis au monde, les considérant comme responsables de notre condition actuelle). À ce titre, on raconte qu’interrogé sur sa principale source de souffrance en cette vie, le Padre Pio aurait répondu sans hésitation: « l’Église ! ». Toutefois, il aurait ajouté immédiatement: « Si le Bon Dieu m’a mis là, c’est que je dois y être. ». Ces propos révèlent parfaitement l’enjeu que le Trône KilI (EL) nous propose.